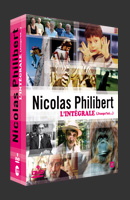Nicolas Philibert ou la solitude partagée

Je dois aux films de Nicolas Philibert, à la Ville Louvre pour commencer, au Pays des sourds ensuite, à la Moindre des Choses en particulier, de m’avoir fait connaître le cinéma documentaire. C’était voici plus de quinze ans. Son travail fit en quelque sorte, à sa façon, ma première éducation en la matière, m’orientant plus tard vers le geste cinématographique de Claire Simon, de Jean-Louis Comolli, de Denis Gheerbrant, de Robert Kramer, avec succès visiblement puisque j’y consacre depuis la plus grande part de mon temps. Pour moi, Nicolas Philibert reste d’abord un très grand passeur.
Comme pour Denis Gheerbrant, mais avec une autre approche, m’avait marqué d’emblée sa volonté de faire lien, son souci d’établir patiemment le contact en dépit d’écarts jamais dissimulés avec des groupes plus ou moins homogènes, en tout cas déjà constitués – personnel des grands musées, classe d’enfants sourds, école de village ou de théâtre, pensionnaires d’une institution psychiatrique sortant de l’ordinaire -, forts de leurs usages, de leurs codes, de leurs rythmes, de leurs rites, leur proposant néanmoins le beau rêve un peu fou d’un film à mener en commun dont tous auraient la charge de chercher ensemble le sujet, à égalité quoique chacun depuis sa place, chemin faisant.
En ces groupes, j’ai aimé de suite la résistance, le fait que rien d’un tel projet ne paraisse au départ aller de soi, contrariant plutôt leurs habitudes, leur raison d’être, leur vocation prioritaire à d’abord s’occuper d’apprentissage ou de soins, considérant le cinéaste peut-être même comme un intrus. En Philibert, j’appréciais au contraire l’entêtement, la croyance, la foi dans le cinéma comme possible bouleversement des rapports et invention constante de relations inédites, ce qui reste pour moi le propre du geste cinématographique. Aussi ai-je toujours attendu dans ses films les premiers moments, parfois tardifs, où « ça passe », la fulgurance des connections, des vraies rencontres, des premières fois, quand les protagonistes sur le point de devenir partenaires se reconnaissent enfin du même monde, quand subitement tout s’embrase et qu’alors « ça sent le film ». Ce sont ces moments dont je me souviens d’abord comme autant de passages, de promesses, de constructions d’espaces communs, n’en appréciant que plus ensuite le chemin comme le travail qui y mène.
Un enfant sourd entreprend de jouer avec la caméra dans son jardin ; dans une autre scène du même film, son instituteur se demande comment font pour vivre ceux qui ne sont pas sourds à force d’entendre tout ce qu’ils entendent (le Pays des sourds) ; dans le grand parc de la clinique de La Borde, un patient informe le cinéaste en fin de tournage qu’il est désormais « entre nous » (la Moindre des choses). Scène après scène, les rapports se précisent, de plus en plus du côté de l’échange et d’un partage cinématographique dont les films portent loin les traces. Au fond, Nicolas Philibert est comme beaucoup d’entre nous : un solitaire en quête de solitude partagée, pour reprendre la belle expression de Jacques Mandelbaum dans le livret qui accompagne l’édition de l’intégrale de ses films (jusqu’ici). Pour moi, cette édition est aussi une reconnaissance de dettes tant on vient tous de quelque part et, dans le cinéma en particulier, d’un cinéaste dont les films, un jour, nous ont fait confiance.